
Depuis son troisième investiture controversée en janvier 2025, Nicolás Maduro impose au Venezuela un autoritarisme qui dépasse largement les frontières nationales. Sa situation précaire en Amérique du Sud révèle une fracture géopolitique majeure qui redessine les alliances régionales et provoque une crise humanitaire sans précédent.
Une réélection contestée qui fracture l’Amérique latine
Le 28 juillet 2024, Nicolás Maduro revendique sa victoire à l’élection présidentielle avec 51,2% des voix selon le Conseil national électoral (CNE). Mais l’opposition, menée par María Corina Machado et représentée par Edmundo González Urrutia, conteste massivement ces résultats. L’opposition affirme détenir les preuves d’une fraude massive avec plus de 67% des voix en faveur de González selon leurs propres procès-verbaux.
Cette élection contestée divise profondément l’Amérique du Sud. Dix pays d’Amérique latine, dont l’Argentine, le Chili, l’Équateur, le Pérou et l’Uruguay, rejettent catégoriquement la validation de la réélection de Maduro. À l’inverse, des pays comme la Bolivie, Cuba et le Nicaragua soutiennent le président vénézuélien, créant un véritable schisme continental.
L’opposition sous pression : répression et clandestinité

María Corina Machado, figure emblématique de l’opposition, vit désormais dans la clandestinité. Lors d’une manifestation le 9 janvier 2025, elle a été brièvement arrêtée puis libérée, illustrant l’escalade répressive du régime. Son équipe dénonce qu’elle a été “violemment interceptée” et contrainte d’enregistrer des vidéos sous la contrainte.
La répression s’est intensifiée depuis juillet 2024. Plus de 2 400 personnes ont été arrêtées lors des troubles post-électoraux, avec 28 morts et 200 blessés. Le procureur général Tarek William Saab a notamment émis un mandat d’arrêt contre Edmundo González Urrutia, contraignant ce dernier à l’exil en Espagne.
Isolation diplomatique et tensions régionales
Le veto brésilien aux BRICS
L’un des échecs les plus symboliques de Maduro concerne son exclusion des BRICS malgré le soutien de la Russie et de la Chine. Le Brésil a opposé son veto à l’adhésion du Venezuela lors du sommet de Kazan en octobre 2024. Lula da Silva, pourtant idéologiquement proche, a justifié cette décision par la “rupture de confiance” après que Maduro a refusé de publier les résultats électoraux détaillés.
Cette exclusion représente un revers géopolitique majeur pour Caracas, qui misait sur cette adhésion pour contourner l’isolement occidental.
Relations tendues avec les voisins
Le Brésil et la Colombie, traditionnels médiateurs régionaux, ont pris leurs distances avec Maduro. Ni Lula ni Gustavo Petro n’ont participé à la cérémonie d’investiture de janvier 2025. Les deux présidents avaient même proposé l’organisation de nouvelles élections, proposition immédiatement rejetée par l’opposition vénézuélienne qui revendique sa victoire.
L’impact migratoire : une bombe à retardement régionale

L’exode vénézuélien constitue la plus grande crise migratoire de l’histoire récente de l’Amérique latine. Plus de 5,5 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays selon l’ONU, soit près de 18% de la population. Cette migration massive met sous pression les pays voisins :
- La Colombie accueille près de 1,8 million de réfugiés vénézuéliens
- Le Pérou en héberge près d’1 million
- Le Chili 455 000, l’Équateur 415 000
Cette crise migratoire génère des tensions sociales et économiques dans les pays d’accueil. L’arrivée massive de migrants fait pression sur les revenus des travailleurs informels et provoque parfois des réactions xénophobes, comme au Chili en 2021.
Sanctions internationales et guerre économique
Le Venezuela subit un arsenal de sanctions sans précédent imposées principalement par les États-Unis depuis 2014. Ces mesures, qualifiées de “guerre économique” par Caracas, visent les secteurs pétrolier, bancaire et militaire.
En réponse, l’Assemblée nationale vénézuélienne a adopté en novembre 2024 une loi punissant de 25 à 30 ans de prison le soutien aux sanctions internationales. Cette législation, baptisée “loi libérateur Simon Bolivar”, illustre la radicalisation du régime face à la pression internationale.
Les alliances alternatives : Russie, Chine et Iran
Face à l’isolement occidental, Maduro renforce ses liens avec les puissances autoritaires. Lors du sommet des BRICS à Kazan, il a exprimé son “admiration pour la grande Russie dans sa bataille contre le nazisme”, référence directe au conflit ukrainien.
La Chine reste un partenaire économique crucial, ayant élevé ses relations avec le Venezuela au niveau d’un “partenariat stratégique à toute épreuve”. Pékin soutient officiellement la candidature vénézuélienne aux BRICS et considère le pays comme “un fournisseur d’énergie fiable”.
Élections factices et consolidation autoritaire
Les élections législatives et régionales du 25 mai 2025 ont confirmé la dérive autoritaire du régime. Boycottées massivement par l’opposition, elles ont donné 82,68% des voix au parti de Maduro avec seulement 42,66% de participation. L’opposition dénonce un “gonflement artificiel” des chiffres de participation.
Ces élections factices permettent à Maduro de contrôler totalement les institutions tout en maintenant une façade démocratique. Le pouvoir a arrêté 70 personnes avant le scrutin, dont Juan Pablo Guanipa, figure de l’opposition.
Perspectives d’avenir : vers une radicalisation ?
La situation de Maduro en Amérique du Sud semble se durcir inexorablement. Son isolement croissant, même parmi ses alliés traditionnels comme le Brésil, le pousse vers une radicalisation autoritaire. Les experts craignent une “trajectoire nicaraguayenne” avec une militarisation accrue du pouvoir.
L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait exacerber les tensions. Le futur secrétaire d’État Marco Rubio, critique virulent des régimes autoritaires latino-américains, promet des sanctions plus sévères. Une prime de 50 millions de dollars a même été mise sur la tête de Maduro par les États-Unis.
La crise vénézuélienne révèle ainsi les limites du multilatéralisme régional et les fractures idéologiques qui traversent l’Amérique du Sud. Entre soutien aux valeurs démocratiques et réalpolitik géopolitique, les pays de la région peinent à trouver une réponse commune face à un régime qui s’enfonce dans l’autoritarisme.
L’avenir du Venezuela dépendra largement de la capacité de l’opposition à maintenir la pression malgré la répression, et de l’évolution des rapports de force géopolitiques dans une région de plus en plus polarisée. En attendant, des millions de Vénézuéliens continuent de fuir un pays jadis prospère, transformant cette crise nationale en défi continental.
Pour approfondir votre compréhension des enjeux géopolitiques sud-américains, découvrez notre dossier complet sur les nouvelles alliances en Amérique latine et leur impact sur l’ordre mondial.
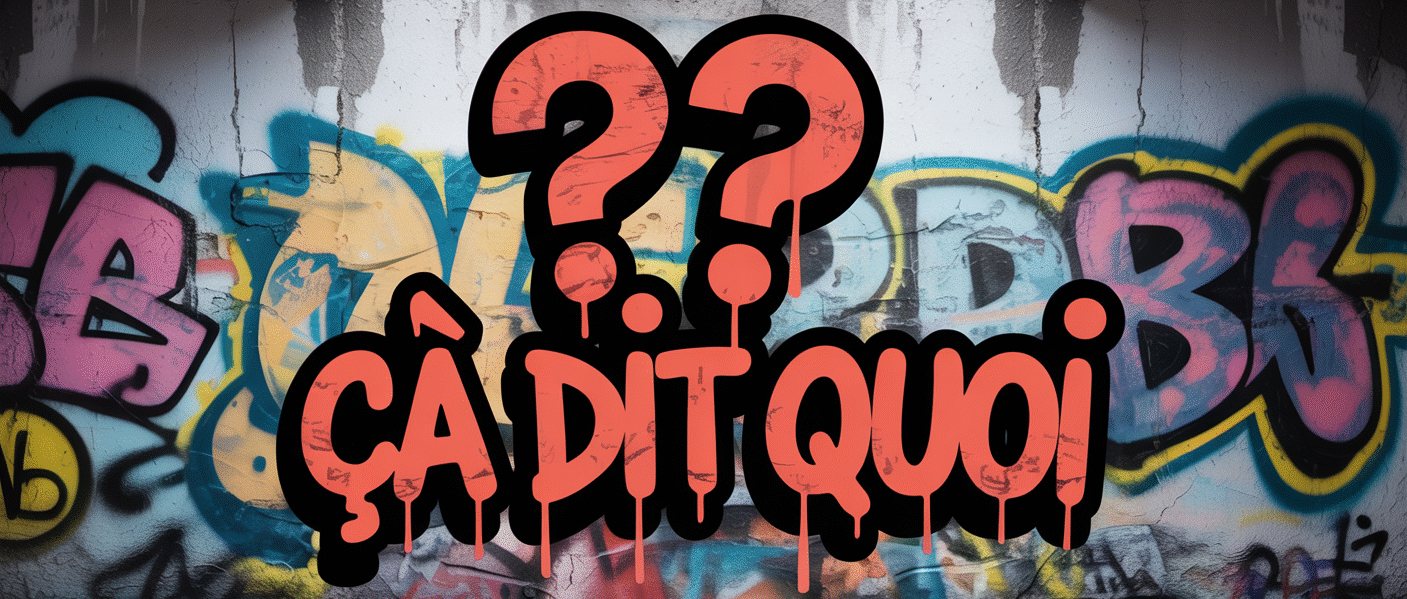






L’actu : dimanche 10 août 2025 - cadiquoi
10/08/2025[…] Venezuela : Maduro entre isolement et autoritarisme, une… […]