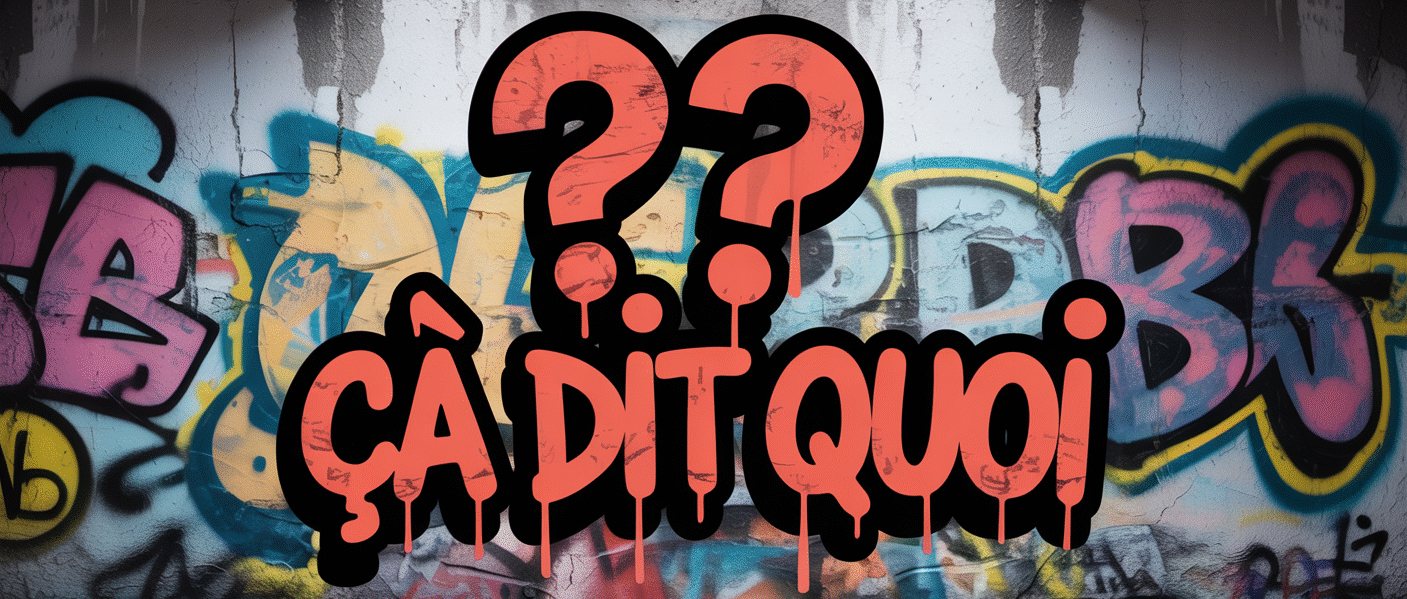Bon les gars, parlons cash d’un truc qui fait beaucoup de bruit en ce moment : la colère qui monte dans nos territoires d’outre-mer. Entre les émeutes en Martinique, les cyclones à Mayotte et la création de fronts indépendantistes, y’a de quoi se demander si c’est juste une question de vie chère ou si on touche à quelque chose de plus profond. Spoiler : c’est un mélange explosif des deux, et ça date pas d’hier.

La vie chère : le déclencheur de toutes les colères
Franchement, quand tu vois les chiffres, tu comprends direct pourquoi ça pète. En Martinique, les produits alimentaires coûtent 30 à 42% plus cher qu’en métropole. En Nouvelle-Calédonie, c’est encore pire avec des prix 34% plus élevés que dans l’Hexagone. Et le plus fou ? Même les produits locaux comme les bananes ou le sucre de canne sont plus chers sur place qu’à Paris.
Concrètement, quand t’es martiniquais avec un revenu médian 25% inférieur à celui des Français de l’Hexagone, et que tu dois payer ta bouffe 40% plus cher, bah tu comprends vite que le système déconne quelque part. À Mayotte, 77,3% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, en Guyane c’est 53%. Ces chiffres, ils font mal, et ils expliquent pourquoi la rue explose.
Le RPPRAC : quand les oubliés prennent la parole
En septembre 2024, un collectif jusqu’alors inconnu a foutu le feu en Martinique : le RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéennes). Leur leader, Rodrigue Petitot, c’est pas un politicien classique – le mec était au chômage et n’avait aucune expérience syndicale. Mais il a réussi un truc que personne n’avait fait : unir les plus précaires autour d’une revendication simple et claire.
Leur méthode ? Les réseaux sociaux, des slogans qui mélangent français et créole, et surtout un discours direct qui touche là où ça fait mal. Le résultat ? Des milliers de manifestants, des centres commerciaux bloqués, et même des violences urbaines qui ont fait 200 entreprises touchées par des pillages.

Les Békés : l’éléphant dans la pièce
Alors là, faut qu’on parle de l’éléphant dans la pièce : les Békés. Ces descendants de colons représentent 1% de la population martiniquaise mais contrôlent 52% des terres agriciles, 90% des entreprises agroalimentaires, et 40% de la grande distribution. Le groupe Bernard Hayot à lui seul fait 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Le problème, c’est pas qu’ils soient riches – le problème c’est le monopole. Entre le moment où un produit est créé et le moment où il arrive dans ton caddie, il passe par 14 intermédiaires en Martinique contre 3 en métropole. Chacun se fait sa petite marge, et au final, c’est le consommateur qui paie pour tout le monde. C’est ce que les manifestants appellent ironiquement la “Taxe sur les Voleurs Ajoutés”.
Du local à l’international : naissance du Front de Décolonisation
Mais la colère, elle dépasse maintenant les simples questions économiques. En janvier 2025, des mouvements indépendantistes de tous les territoires d’outre-mer ont créé le Front International de Décolonisation (FID) à Nouméa. Leur objectif ? Faire inscrire la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sur la liste des territoires à décoloniser de l’ONU.
Le truc qui fait scandale, c’est le soutien affiché de l’Azerbaïdjan via le Baku Initiative Group. Paris crie à l’ingérence, mais les indépendantistes assumèrent totalement cette alliance internationale. Pour eux, c’est juste logique : si tu veux te faire entendre sur la scène mondiale, tu cherches des soutiens où tu les trouves.

Les réponses de l’État : pansements ou vrais remèdes ?
Face à cette montée des tensions, l’État français multiplie les mesures d’urgence. Exemption de TVA sur 6000 produits en Martinique, création d’un ministère dédié avec Manuel Valls, discussions sur de nouveaux statuts… Mais pour beaucoup d’Ultramarins, c’est trop peu, trop tard.
Le problème de fond, c’est que ces mesures s’attaquent aux symptômes sans traiter les causes structurelles. Comme le souligne le Sénat dans son rapport de mars 2025, on en est toujours aux “pansements” plutôt qu’aux “vrais remèdes”. Les mêmes économies de comptoir héritées de la colonisation persistent, les monopoles restent en place, et les écarts de revenus se creusent.
Entre réformes et indépendance : quel avenir ?
Alors, vie chère ou désir d’indépendance ? En fait, c’est les deux mon capitaine. La vie chère, c’est le déclencheur immédiat, ce qui fait sortir les gens dans la rue. Mais derrière, il y a une vraie remise en question du lien colonial qui unit ces territoires à la France.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : aux présidentielles de 2022, Marine Le Pen est arrivée en tête dans tous les DOM-TOM sauf dans le Pacifique. L’extrême-droite gagne du terrain, les mouvements indépendantistes aussi – signe que le système actuel satisfait de moins en moins.
En Nouvelle-Calédonie, les accords de Bougival de juillet 2025 ont créé un “État de Nouvelle-Calédonie” avec sa propre nationalité, mais les indépendantistes du FLNKS les ont rejetés parce qu’ils ne prévoient pas de nouveau référendum sur l’indépendance.
Conclusion : le temps des demi-mesures est fini
La colère des outre-mer, c’est pas juste un caprice de gosses gâtés. C’est l’expression d’un ras-le-bol historique face à un système économique et politique à bout de souffle. Entre économie de rente, monopoles hérités de l’époque coloniale et sentiment d’abandon par la métropole, les ingrédients étaient réunis pour l’explosion.
La France a le choix : soit elle accepte de refonder profondément sa relation avec ces territoires en s’attaquant aux vraies causes structurelles, soit elle risque de voir partir des morceaux entiers de la République. Parce qu’à force de traiter les symptômes sans soigner la maladie, même les plus attachés à la France finissent par regarder ailleurs.
Pour aller plus loin, découvrez notre article sur les vraies conséquences de la crise de 2008 dans la street