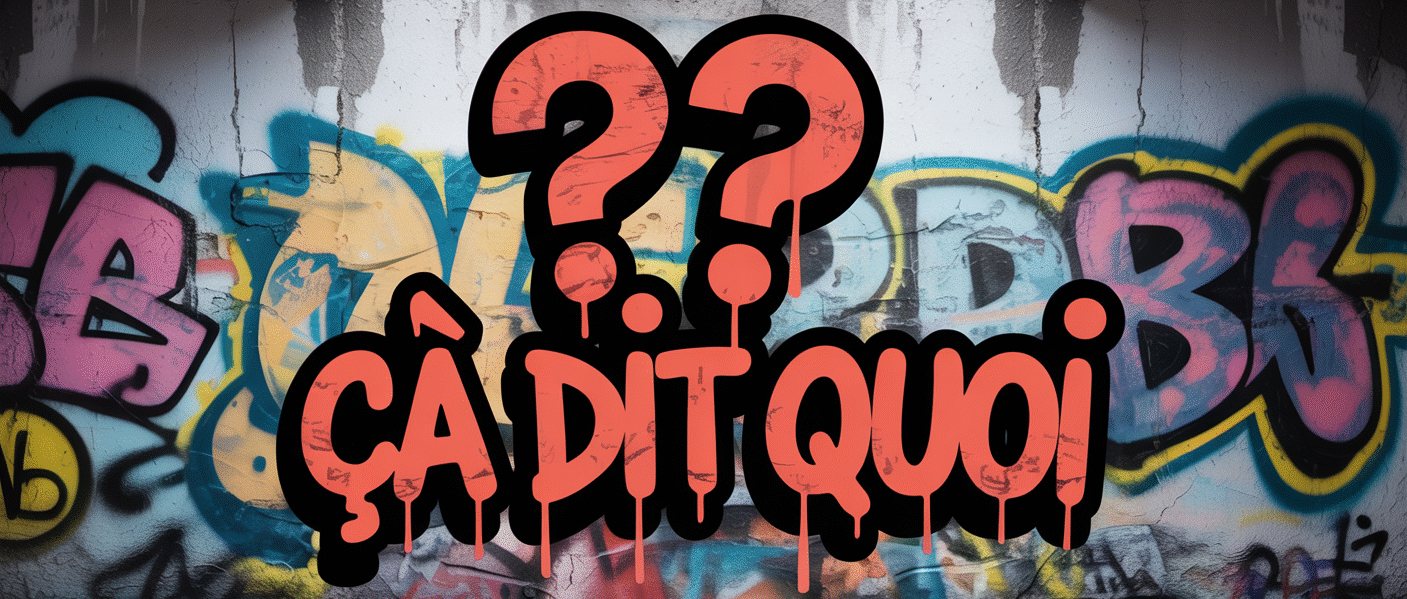Le paysage géopolitique africain traverse actuellement une transformation majeure qui redessine fondamentalement les relations entre la France et le continent. Face à l’émergence de nouveaux acteurs internationaux et à la montée des aspirations souverainistes africaines, çadiquoi vous dévoile les bouleversements qui sont en train de changer la donne.
La fin de l’hégémonie française traditionnelle
Le réveil géopolitique africain est en marche. Après des décennies de relations privilégiées avec la France, les pays africains diversifient massivement leurs partenariats stratégiques. Cette transformation s’illustre de manière spectaculaire par les retraits militaires français successifs : après le Mali (2022), le Burkina Faso (2023) et le Niger (2024), c’est désormais le Sénégal et la Côte d’Ivoire qui ont mis fin aux accords de coopération militaire avec l’Hexagone.
Emmanuel Macron a lui-même reconnu cette nouvelle réalité lors de son déplacement en Éthiopie et à Djibouti en décembre 2024, cherchant à pivoter vers l’Afrique de l’Est pour compenser les pertes d’influence dans les anciennes zones francophones. Cette stratégie de réorientation témoigne de l’ampleur du défi français face aux nouvelles dynamiques continentales.
L’offensive russe : de Wagner à Africa Corps

La Russie s’impose comme l’alternative sécuritaire de choix pour de nombreux régimes africains. L’évolution de Wagner vers Africa Corps marque une institutionnalisation de la présence russe sur le continent. Depuis janvier 2024, Africa Corps a déployé des centaines de mercenaires au Burkina Faso et s’est imposé au Niger avec l’arrivée de 100 paramilitaires sur la base de Niamey.
Cette stratégie russe combine habilement assistance militaire et concessions économiques. Au Mali, l’Africa Corps contrôle des mines d’or stratégiques tout en fournissant un soutien militaire au régime. L’approche moscovite séduit par sa promesse de non-ingérence politique, contrastant avec les conditionnalités démocratiques occidentales.
La percée chinoise et turque
La Chine maintient sa stratégie d’investissements massifs dans les infrastructures africaines, avec des projets phares comme la modernisation du port de Djibouti. Pékin privilégie une approche économique de long terme, évitant l’intervention militaire directe tout en consolidant sa présence stratégique via sa base militaire à Djibouti.
La Turquie émerge comme un concurrent redoutable, exploitant ses liens religieux avec 26 pays africains membres de l’Organisation de la coopération islamique. Ses drones Bayraktar sont devenus des symboles de souveraineté pour les régimes sahéliens. Ankara mise sur une stratégie hybride combinant armement, influence religieuse et projets de développement.
Les nouvelles configurations régionales
L’Alliance des États du Sahel bouleverse l’ordre établi
La création de l’AES par le Mali, le Burkina Faso et le Niger en septembre 2023 constitue une rupture historique avec l’ordre régional traditionnel. Ces trois pays ont officiellement quitté la CEDEAO en janvier 2024, créant leur propre passeport et développant une force de défense commune.
Cette alliance, inspirée du “modèle OTAN” selon ses dirigeants, illustre la volonté de construire une coopération africaine autonome. Le Maroc s’impose comme partenaire privilégié de l’AES, avec des projets d’envergure comme l’Initiative Atlantique pour désenclaver ces pays.
L’essor des BRICS+ africains
L’expansion des BRICS transforme les équilibres continentaux. Après l’Égypte et l’Éthiopie en 2024, le Nigeria, l’Algérie et l’Ouganda ont rejoint le groupe comme pays partenaires. Cette adhésion massive témoigne de la quête de multipolarité des États africains face à l’ordre occidental traditionnel.
Les nouveaux corridors de puissance
Corridors énergétiques continentaux
L’Afrique développe ses propres axes énergétiques. Le gazoduc Nigeria-Maroc, projet de 20 milliards de dollars traversant 11 pays, illustre cette ambition d’intégration Sud-Sud. Parallèlement, le pipeline d’hydrogène vert Namibie-Afrique du Sud marque une rupture avec les modèles exportateurs vers l’Europe.
La ZLECAf : vers l’autonomie commerciale
La Zone de libre-échange continentale africaine concrétise l’ambition d’un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs. Avec l’objectif de tripler le commerce intra-africain d’ici 2030, cette initiative vise à réduire la dépendance aux partenaires extérieurs traditionnels.
Les États-pivots de la nouvelle Afrique
Trois puissances africaines émergent comme architectes de ces transformations :
- Le Nigeria : première économie du continent, devient le premier partenaire commercial africain de la France tout en diversifiant vers les BRICS
- L’Égypte : membre des BRICS, développe une diplomatie panafricaine en renforçant ses liens avec Abuja et d’autres capitales
- Le Maroc : partenaire privilégié de l’AES et plateforme énergétique continentale via ses méga-projets
La riposte française : adaptation ou déclin ?
Face à ces défis, la France repense sa stratégie africaine autour de trois axes :
- Pivot vers les économies anglophones (Nigeria, Ghana, Éthiopie)
- Partenariats économiques décolonisés sans conditionnalités politiques
- Initiative 4P (Pacte pour la prospérité des peuples et de la planète) avec 72 pays partenaires
Cependant, cette diplomatie de rattrapage peine à convaincre. Les opinions africaines restent sceptiques face aux promesses de renouveau, préférant souvent les alternatives proposées par les nouveaux partenaires.
L’Afrique, acteur et non plus terrain de jeu
Ces transformations révèlent une mutation fondamentale : l’Afrique passe du statut d’objet géopolitique à celui d’acteur stratégique. Les dirigeants africains exploitent désormais la concurrence entre puissances pour maximiser leurs marges de manœuvre et affirmer leur souveraineté.
Cette nouvelle configuration multipolaire offre aux États africains des opportunités inédites de diversification stratégique, mais elle génère aussi de nouveaux risques de fragmentation régionale, comme l’illustre la rupture entre l’AES et la CEDEAO.
L’ère des relations exclusives touche à sa fin. Dans cette Afrique recomposée, la France doit accepter de n’être qu’un partenaire parmi d’autres, dans un continent qui écrit désormais sa propre partition géopolitique. Les alliances traditionnelles cèdent la place à des partenariats pragmatiques et diversifiés, redéfinissant durablement les équilibres de puissance sur le continent noir.