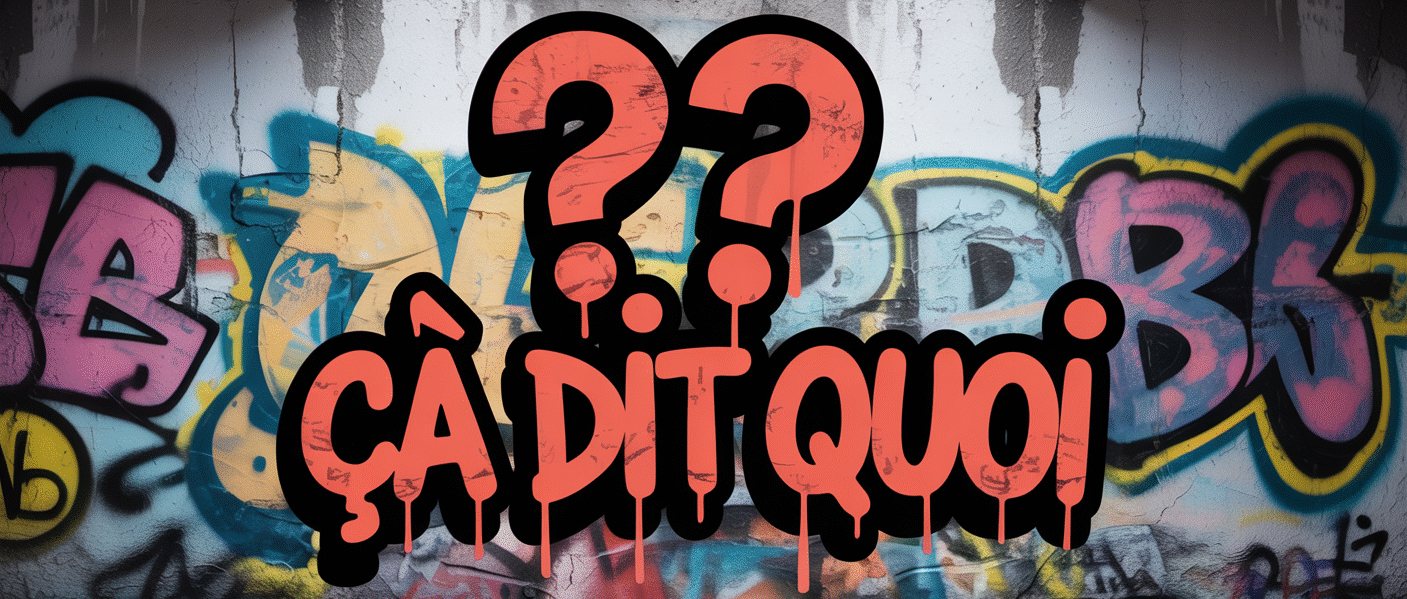Les années 80 ont été marquées par une explosion de tensions raciales en France, avec des “étés chauds” dans les banlieues, des crimes racistes qui se multipliaient et des violences policières qui ont finalement mené à une mobilisation historique. La blessure par balle de Toumi Djaïdja aux Minguettes le 20 juin 1983 sera l’étincelle qui déclenchera la première grande marche antiraciste de France. Cette période sombre de l’Hexagone révèle comment la discrimination systémique et les tensions sociales ont poussé toute une génération de jeunes issus de l’immigration à prendre la parole de manière pacifique.

L’été 1981 : Première explosion aux Minguettes
Tout commence vraiment à l’été 1981 aux Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. Pour la première fois en France, on assiste à des “rodéos” automobiles et à des affrontements violents entre jeunes et forces de l’ordre qui vont choquer l’opinion publique.
Ces événements ne sortent pas de nulle part. La crise économique frappe de plein fouet cette zone urbaine prioritaire (ZUP) construite dans les années 60. Renault-RVI, principal employeur du secteur, supprime 5000 emplois en 1978. Entre 1978 et 1982, Vénissieux perd 10 000 habitants, principalement les classes moyennes qui partent vers des communes plus favorisées.
La situation sociale se dégrade rapidement. Sur les 9200 logements des Minguettes, 2000 à 3000 étaient vides en 1983. Le chômage touche particulièrement les jeunes issus de l’immigration maghrébine, confrontés aux discriminations à l’embauche. Comme l’explique un jeune Vénissian en 1980 : “Il y a aussi la nationalité qui fait du tort. Quand on apprend que je suis Algérien, on me dit très souvent qu’il y a beaucoup de candidats et que j’ai peu de chances”.
1981-1982 : Les “étés chauds” se multiplient
L’embrasement se propage rapidement aux “3V” de l’Est lyonnais : Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Villeurbanne. Les médias découvrent ces territoires qu’ils qualifient de “banlieues maudites” avec leurs images spectaculaires de voitures qui brûlent et d’affrontements nocturnes.
À Villeurbanne, la rue Olivier-de-Serres devient un symbole. La presse parle d’“harlémisation maghrébine” dès 1975. Plus de 95% des familles du quartier sont d’origine maghrébine en 1977, après le départ des populations européennes vers des logements plus récents.
La cité de la Grappinière à Vaulx-en-Velin connaît ses premières rébellions urbaines dès 1971. Les pratiques de rodéos se développent : voler une berline puissante, de préférence allemande, et la conduire à tombeau ouvert dans les cités avant de l’abandonner ou de la brûler.
1983 : L’année de tous les dangers
La grève de la faim qui change la donne
En avril 1981, le père Christian Delorme, le pasteur Jean Costil et le jeune Hamid Boukrouma mènent une grève de la faim de 29 jours pour protester contre les expulsions de jeunes étrangers. Cette action obtient gain de cause : le gouvernement Mauroy suspend les expulsions des jeunes arrivés en France avant 10 ans.
Cette victoire bouleverse l’équilibre des rapports de force. Comme l’explique le préfet de police Jean Chevanche : “La suspension des expulsions ne peut que rendre plus difficile l’action des services de police ; aucune menace ne pèse sur les malfaiteurs étrangers”. La police perd un de ses outils de pression les plus efficaces.
Les crimes racistes s’accumulent
L’année 1983 est particulièrement meurtrière pour les jeunes issus de l’immigration. Selon le ministère de l’Intérieur, 5 Maghrébins sont tués pour motifs racistes. Les organisations antiracistes parlent de 21 victimes.
Parmi les crimes qui marquent l’opinion :
- Yazid Naili à Strasbourg
- Ghruie Abdelkader à Valenton
- Lahouari ben Mohamed à Marseille
- Mohamed Larbi à Saint-Avertin
- Ahmed Bouteldja et Wahid Hachichi à Lyon
- Toufik Ouannès, 9 ans, tué à La Courneuve le 9 juillet
- Habib Grimzi, jeté du train Bordeaux-Vintimille le 14 novembre

La montée du Front National
En parallèle, le Front National réalise sa première percée électorale significative aux élections municipales partielles de Dreux en septembre 1983. Jean-Pierre Stirbois obtient 16,72% des voix au premier tour, un score sans précédent pour ce parti jusque-là groupusculaire.
La campagne drouaise exploite tous les ressorts de la peur : “mise en cause nominative d’immigrés algériens, instrumentalisation mensongère des faits divers, déversement ininterrompu de fausses nouvelles”. Le 11 septembre 1983, l’alliance RPR-FN remporte la mairie.
21 mars 1983 : L’explosion aux Minguettes
Une perquisition de police dégénère complètement le 21 mars 1983 dans le quartier de Montmousseau. Une douzaine de policiers sont blessés, des véhicules endommagés. Les habitants, y compris des mères de famille, participent aux affrontements.
Comme le raconte un témoin : “Il y avait des unités de différents corps policiers, des unités de gardes mobiles, des lacrymogènes. Je me suis retrouvé en bas de la Démocratie avec un flic qui avait un flingue, braqué sur moi. Ma propre mère, ce jour-là, avait ramassé une grosse baffe par une femme flic dans l’ascenseur”.
Pour calmer la situation, Christian Delorme et Jean Costil convainquent plusieurs jeunes d’entamer une grève de la faim qui débute le 28 mars. Cette action crée l’association SOS Avenir Minguettes le 27 avril 1983, présidée par Toumi Djaïdja.
20 juin 1983 : La balle qui changera tout
Dans la nuit du 19 au 20 juin 1983, durant le ramadan, un nouvel affrontement oppose jeunes et policiers aux Minguettes. Toumi Djaïdja, 19 ans, président de SOS Avenir Minguettes, voit un jeune aux prises avec un chien policier. Il s’interpose pour le protéger.
Un policier lui tire dessus à bout portant. La balle traverse l’estomac du jeune homme qui est transporté d’urgence à l’hôpital, entre la vie et la mort. Quarante ans après, Toumi Djaïdja se souvient : “Un policier m’a tiré dessus, je me demande encore pourquoi”.

C’est sur son lit d’hôpital que naît l’idée de la marche. Christian Delorme et Jean Costil lui rendent visite et proposent une action non-violente inspirée de Martin Luther King et Gandhi. L’objectif : transformer la colère en force pacifique de changement.
Les mouvements militants des jeunes issus de l’immigration
Zaâma d’Banlieue : Les précurseurs autonomes
Dès 1979, le collectif Zaâma d’Banlieue émerge à Lyon. Fondé par quatre jeunes femmes d’origine algérienne (Djida Tazdaït, Tim, Nadia et Farida), ce mouvement autonome dénonce les contrôles au faciès, les violences policières et les crimes racistes.
Le terme “Zaâma” signifie “prétendre” en arabe dialectal, utilisé de manière ironique pour remettre en question les discours dominants. Ces militantes adoptent un style vestimentaire inspiré de Tina Turner et Madonna, défiant les codes traditionnels.
Zaâma d’Banlieue s’oppose à la “beuritude” sous influence des antiracistes chrétiens. Elles préfèrent une approche conflictuelle et autonome, critiquant même la Marche de 1983 qu’elles jugent trop encadrée par des non-immigrés.
Le rôle des organisations chrétiennes
La Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués) joue un rôle central. Cette organisation protestante d’aide aux étrangers emploie Jean Costil comme délégué régional à Lyon de 1979 à 2007.
Le père Christian Delorme, surnommé le “curé des Minguettes”, développe depuis 1975 des liens privilégiés avec les familles maghrébines du quartier. Membre de l’Institut du Prado, il a pour mission d’aller vers les pauvres et les non-chrétiens.
Vers la Marche : L’idée prend forme
Le Forum Justice du 23 juillet 1983
SOS Avenir Minguettes organise un Forum Justice à Vénissieux le 23 juillet 1983, avec le soutien de Zaâma d’Banlieue, Wahid Association et Lignes parallèles. L’objectif : interpeller les pouvoirs publics sur les “déviances policières et les assassinats de jeunes” dans l’agglomération lyonnaise.
L’appel du Larzac
Le 1er août 1983, lors du rassemblement antimilitariste du plateau du Larzac, SOS Avenir Minguettes et la Cimade lancent le premier appel à la “Marche pour l’égalité”. L’idée est lancée : traverser la France à pied pour porter la voix des banlieues jusqu’à l’Élysée.
Deux revendications principales émergent : obtenir une carte de séjour de dix ans pour sécuriser le statut des immigrés et le droit de vote pour les étrangers aux élections locales.

L’impact de ces événements
Une prise de conscience nationale
Ces événements des années 80 révèlent au grand jour la “question des banlieues” qui va structurer le débat public français pendant des décennies. Les Minguettes deviennent le symbole des difficultés d’intégration et du racisme institutionnel.
La médiatisation des “rodéos” et des affrontements crée une imagerie durable qui associe jeunesse issue de l’immigration, banlieues et violence. Cette représentation va nourrir les discours sécuritaires et l’émergence électorale du Front National.
Les leçons de l’histoire
Quarante ans après, le sociologue François Dubet note la répétition du cycle : “Depuis quarante ans, le cycle se répète sans cesse : les adolescents qui ont mis le feu aux voitures, à Nanterre et ailleurs, en juin et juillet 2023, sont les petits-enfants de ceux que j’ai rencontrés aux Minguettes dans les années 1980”.
La singularité de 1983 réside dans sa dimension politique : les jeunes transforment leur révolte en mobilisation de masse, s’inscrivent dans l’agenda politique et obtiennent des avancées concrètes.
Conclusion
Les événements des années 80 qui ont mené à la Marche pour l’égalité révèlent comment une succession de crises sociales, de violences policières et de crimes racistes peut générer une mobilisation historique. La blessure de Toumi Djaïdja cristallise des années de tensions et d’injustices, mais aussi l’émergence d’une nouvelle génération politique.
Cette période illustre aussi les limites de l’action publique face aux inégalités territoriales et au racisme systémique. Malgré les promesses et les politiques de la ville, les mécanismes de discrimination et d’exclusion perdurent, comme en témoignent les révoltes récentes.
L’héritage de cette époque questionne notre capacité collective à tirer les leçons du passé et à construire une société véritablement égalitaire. La mémoire de ces événements reste plus que jamais d’actualité dans une France qui peine encore à réconcilier ses idéaux républicains avec ses réalités sociales.
Tu veux capter toute l’histoire des banlieues et des mouvements sociaux en France ? Plonge encore plus loin avec ces deux articles incontournables sur çadiquoi ! ⚡️ Si la Marche pour l’égalité t’a marqué·e, tu vas kiffer comprendre les origines et combats du 93… et découvrir les bavures qui ont secoué l’Hexagone. 👀👇